29/01/2012
Philippe Sollers
Bloc-Notes, 29 janvier / Les Saules - Nyon

Ce qu'il y a de bien avec les livres, c'est qu'ils parviennent parfois à rendre intelligentes, voire heureuses, des heures qui sans l'ombre qu'ils projettent sur la cour, traduiraient un profond ennui. J'y ai pensé, observant de bon matin avec un léger sourire, mes compagnons de voyage insupportablement conformes à un paysage gris dépouillé de rêves, ou le reposoir technologique d'un quotidien professionnel qui n'a plus rien à m'apprendre, en lisant les premières pages - somptueuses - de L'éclaircie de Philippe Sollers, que vous pouvez retrouver dans la rubrique Morceaux choisis: l'esquisse d'un cèdre, dans l'histoire, sur une photographie, dans sa vie.
Comme il l'avait fait dans Trésor d'amour, se mêlent plusieurs aventures dans le dernier roman de Philippe Sollers, dont celle de la défunte soeur bien-aimée du narrateur, Anne, qui lui rappelle le portrait de Berthe Morisot, peinte par Edouard Manet: Je pense à toi en voyant le portrait de Berthe Morisot au bouquet de violettes, la future belle-soeur de Manet, que ce dernier a peint en 1872. On dirait qu'elle est en grand deuil, mais elle est éblouissante de fraîcheur et de gaieté fine. Ce noir éclatant te convient. Ce que Manet a découvert dans le noir? Le regard du regard, l'interdit qui dit oui, la beauté enrichie du néant.
Puis nous découvrons Lucie, la quarantaine, spécialiste en archéologie et collectionneuse de manuscrits. Elle lui rappelle à la fois Anne et Berthe Morisot. Ils se rencontrent sous les toits, rue du Bac: Les premiers mots que je lui chuchote lorsqu'on se retrouve, rideaux fermés, après l'avoir embrassée et avant qu'elle se déshabille, sont: Désennuyons-nous. Je lui dis "vous" dans la conversation, et "tu" pendant la séance. On change de corps entre le "tu" et le "vous", la voix du "tu" n'est pas celle du "vous". Les fantasmes réalisés sont en "tu", les raisonnements en "vous". Ordre nécessaire: le basculement du "vous" au "tu" est gênant, le contraire soulage. Une fois desennuyés, la conversation est plus libre, légère. On fait l'amour en "tu", en se parle normalement en "vous". Sol mineur, ré majeur. Trois-quarts d'heure en "tu", une heure et demie en vous".
Comme dans Trésor d'amour où la romance avec Minna entraînait le lecteur dans les rues de Venise et sur les traces de Stendhal, L'éclaircie emprunte la même approche, pour nous dérouler le tapis rouge devant Edouard Manet et Pablo Picasso, tant ces hommes libres que leurs oeuvres. Philippe Sollers les fait revivre sous nos yeux comme au cinéma. Silence, on tourne! Même enthousiasme quand il nous parle des manuscrits de Casanova ou des quatuors de Joseph Haydn. Pourtant, dès le premier tiers du roman, on peine à se débarrasser d'une impression de déjà vu. A peine un grain de sable qui freine notre ardeur. Un déséquilibre dans la structure du récit, entre les personnages modernes et ceux qui surgissent du passé? Oubien cela tient-il à Lucie qui manque singulièrement de relief - le contraire de Minna - entourée de ces monstres sacrés? Trop de digressions, de bavardages, de répétitions? Le big-bang, les chinois, les séries TV, l'archimilliardaire des cosmétiques, etc.
Songeant aux yeux d'Anne, de Lucie, de Berthe Morisot, le narrateur de L'éclaircie note: Trop de mots toujours, trop de phrases. On ne vous en demande pas tant. Dommage que son alter ego, de l'autre côté du miroir, ne s'en soit pas souvenu...
Cela dit, même si le dernier accouchement littéraire de Philippe Sollers n'est pas du meilleur cru, il se retrouve, débarrassé de son habit d'apparat, dans ces quelques phrases qui font qu'on lui pardonne la plupart de ses outrecuidances ou cabotinages: Toutes et tous me poussent vers la mort, alors que quelque chose me pousse sans arrêt vers la vie. Deux fois par an, au bord de l'eau, j'embrasse les arbres, surtout le vieux cèdre et le jeune acacia. Je les revois toujours pour la première et la dernière fois.
Cette faculté de partager ses émerveillements demeure toute sa richesse de jeune homme aux cheveux blancs. C'est à travers elle qu'à peine sorti de L'éclaircie, on se précipite sur un livre consacré à Edouard Manet et Pablo Picasso, ou mieux, qu'on se rend au musée, vite! En cela, au moins, ce livre est une réussite...
Philippe Sollers, L'éclaircie (Gallimard, 2012)
Philippe Sollers , Trésor d'amour (Gallimard, 2011)
image: Edouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe (1862-1863)
23:57 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Joseph Haydn, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
Santo Piazzese
 Santo Piazzese, Le souffle de l'avalanche, Seuil, 2005)
Santo Piazzese, Le souffle de l'avalanche, Seuil, 2005)
Troisième opus de cet auteur sicilien – dont les deux premiers sont malheureusement indisponibles – Le souffle de l’avalanche nous fait pénétrer au cœur de l’âme sicilienne, inquiétante et fantastique, avec le meurtre de la Zisa que le commissaire Spotorno s'efforce d'élucider. Par un pouvoir des mots et des situations convaincantes, nous nous laissons envoûter par les rues de Palerme où une Dame Blanche, très pâle, apparaît et disparaît au gré des événements qui conduisent au cimetière des Rotoli. Un roman policier ? L'un des meilleurs crûs italiens, à considérer davantage comme un roman à la Simenon, séduisant par son atmosphère et ses personnages complexes dont émerge peu à peu le véritable héros de ce livre, la Sicile, dans le sang et les larmes.
00:02 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Littérature policière | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
26/01/2012
Morceaux choisis - Monique Rivet
Monique Rivet

Cette ville s'est enfoncée dans ma mémoire. Avec l'éloignement la réalité de cette époque de ma vie est devenue improbable, j'éprouve comme un besoin de la rattacher à des certitudes qui dépassent l'horizon exigu d'un passé individuel, de l'accrocher à l'histoire, à ses faits avérés. La plus lointaine, la plus récente.
La plus lointaine, celle qui a vu les légions romaines régner sur cette terre, et il me plaît qu'ait soufflé ici aussi le grand vent dont Rome a balayé le monde. La plus récente, celle que j'ai connue: cette ville, sa tragédie étouffée, minuscule dans le chaos environnant mais microcosme où se vivait, où nous vivions le bouleversement de tout un pays.
Ce pays, je ne lui appartenais pas; je m'y trouvais par hasard. J'y étais de guingois avec tout, choses et gens, frappée d'une frilosité à fleur de peau, incapable d'adhérer à aucun des mouvements qui s'y affrontaient. Cette guerre, je ne la reconnaissais pas, elle n'était pas la mienne. Je la repoussais de toutes mes forces. Si j'avais eu à la faire... s'il avait fallu que je la fasse, aurais-je pu la faire aux côtés des miens?
Je l'ai oubliée. Je ne suis pas la seule: nous l'avons tous oubliée, ceux qui n'ont pas eu le choix et ceux qui ont refusé de choisir; ceux qui n'ont pas voulu s'en mêler et ceux qui s'y sont perdus. Quelquefois un mot, un simple nom propre dans une conversation, réveille un souvenir à la lumière duquel réapparaissent l'impuissance et l'amertume d'antan, mais parfois aussi une connivence surgit entre vous et l'inconnu qui vous parle, dont vous ne savez rien, qui était peut-être de ceux que vous condamniez jadis, que vous jugiez aveugles - et cet inconnu, vous ne lui demandez pas son passeport et son passé parce que c'est un visage soudain fraternel qui vous regarde ou plutôt qui regarde avec vous, avec vos yeux, un pays plein de soleil et de silence où rien désormais ne peut vous faire ennemis.
Monique Rivet, Le Glacis (Métailié, 2012)
20:41 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
24/01/2012
Georges Bernanos
 Georges Bernanos, Nouvelle histoire de Mouchette (coll. Livre de poche/LGF, 2012)
Georges Bernanos, Nouvelle histoire de Mouchette (coll. Livre de poche/LGF, 2012)
Sans le courage de certains éditeurs - Le Castor Astral, en 2009 - certains chefs d’œuvres auraient sombré dans l'oubli, tels la Nouvelle histoire de Mouchette de Georges Bernanos, enfin réédité en format de poche pour un plus large public.
Tragédie du mal sous toutes ses formes – conformisme social, matérialisme, violence ou mensonge – ce roman nous dévoile le destin de Mouchette, une jeune fille de 14 ans, confrontée à l’indifférence de sa famille : une mère à l’agonie, un père et ses grands frères qui cherchent dans l’ivresse à oublier leur condition misérable. A la faveur d’une tempête, rentrant de l'école, elle s'égare en forêt et croise le chemin d’Arsène le braconnier qui l'accueille, puis la séduit et sous l'emprise de l'alcool, abuse d’elle. Seule, rejetée dans cet environnement qui ne lui fait aucun cadeau – même son institutrice la livre aux moqueries de ses camarades de classe – elle choisit, pour en finir avec le désespoir, la honte et le dégoût qui submergent son innocence perdue, de mettre fin à ses jours.
Aucun roman contemporain ne m’aura à ce point ébranlé. De toute évidence, ce texte écrit en 1937, transposé dans un contexte plus universel, incite à penser que Mouchette est le visage de la France humiliée, bafouée, en proie à la folie des hommes - leur lâcheté, leur mépris - comme si seule une grâce divine saurait illuminer les ténèbres insinuées dans la moindre des réalités.
00:00 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
20/01/2012
Christian Signol
Bloc-Notes, 20 janvier / Les Saules

Je me souviens d'avoir lu avec enchantement, voici bien des années, le livre Marie des brebis, puis dans la foulée, Les cailloux bleus et Les menthes sauvages - tous disponibles en coll. Pocket - avant de retrouver Christian Signol voici deux ans avec un roman très attachant, Une si belle école, présenté dans les colonnes de La scie rêveuse.
Au coeur des forêts, paru l'automne dernier en librairie, parvient une fois encore à nous étonner et nous émerveiller. L'histoire pourtant, est toute simple. Bastien Fromenteil, à près de soixante-dix ans, est un forestier qui vit seul sa passion de toujours, la forêt voisine. Sans s'appesantir sur le passé, il égrène ses souvenirs de vieil homme: l'évocation de son père et de son épouse défunts, celui de sa fille Jeanne partie pour la ville, celui enfin de sa soeur Justine, disparue sans laisser de trace et qui maintient en lui une douleur tenace, sous le regard complice de la voisine de toujours, Solange, qui prépare les repas sous son toit. Sa vie bien règlée ne semble plus lui réserver de surprises, jusqu'au jour où sa petite-fille Charlotte lui annonce sa venue.
Heureuse de retrouver son grand-père et l'odeur familière du bois de son enfance, elle est pourtant désemparée, atteinte d'une maladie grave - le sarcome d'Ewing - qui affecte une de ses jambes et l'oblige à suivre une chimiothérapie. Désormais, je savais: j'avais lu la gravité de la maladie de Charlotte dans ses yeux, dans son corps, dans ses gestes, sur son visage et je me demandais comment on pouvait tomber si malade à moins de trente ans. Pour moi, la maladie ne doit venir qu'avec la vieillesse.
Ils ne savent pas encore, Bastien et Charlotte, que leurs retrouvailles - avec des périodes d'absences et de silences mêlés de craintes - vont, avec l'aide de la médecine tout de même, les réconcilier avec le monde, passant par la magie de cette forêt qui les fait vibrer à la même mesure, éclaire leur vie et leur en révèle le sens: Les arbres sont des êtres vivants capables de colère, de rancune aussi bien que de compassion. Il suffit de savoir déchiffrer leur langage pour les comprendre, ce qui évidemment n'est pas donné à tout le monde: il y faut une grande attention, beaucoup de soins, de complicité. Il faut savoir devenir arbre, aimer la pluie et la lumière, murmurer dans le vent ce que personne n'a jamais dit et ne dira jamais. (...) Le coeur des forêts ne cesse jamais de battre.
Auprès de Charlotte qui prend de plus en plus de place dans son existence et lui partage un ailleurs qu'il ne connaît pas - son voyage au Québec: le Saint-Laurent, Chicoutimi et les Trois-Rivières - ses blessures intimes s'atténuent peu à peu, avec la guérison progressive de Charlotte et le voile levé sur le mystère de Louise, grâce aux nouvelles technologies - Internet - qui n'ont aucun secret pour sa petite-fille.
Tous les personnages de ce roman - même ceux qui traversent ce livre comme un éclair - ont leur importance et Christian Signol sait trouver les mots justes et simples pour suggérer la beauté des sentiments et de cette nature qui nous confronte à nous-mêmes. Il règne, dans Au coeur des forêts, un léger parfum d'éternité, comme dans ces églises absentes du guide Michelin dont le rayonnement n'est perceptible qu'à ceux qui prennent le temps de s'attarder, de s'imprégner du lieu, d'être à l'écoute du temps.
La clef de ce livre se trouve sans doute dans la citation de Jean Giono, que Christian Signol nous partage en préambule à son récit envoûtant: Ce dont on te prive, c'est de vents, de pluies, de neiges, de soleils, de montagnes, de fleuves, de forêts: les vraies richesses de l'homme...
Christian Signol, Au coeur des forêts (Albin Michel, 2011)
00:53 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
09/01/2012
Morceaux choisis - Clémence Boulouque
Clémence Boulouque

Les jours passent. Ari rentre immanquablement avec des sacs lourds de ses courses, ces provisions pour m'enfermer, et je pense aux générations de femmes recluses, à toutes celles qui vivent la même séquestration entre les mains de despotes qui se croient généreux.
Il s'est rendu intrus. Mon corps le rejette, il se condense, se referme comme mon regard s'est clos, lui aussi. La porosité de nos corps à la lumière, à l'air, est un signe: le bonheur est porosité et je suis occlusion. (...)
Je tords le ciel, où je consignais mes rêves, ne le regarde plus qu'avec méfiance. Je voudrais aussi esorer mon ventre pour lui faire cracher ce qui le tuméfie et s'y est peut-être installé. Mon souffle se calme, mais mon esprit inspire régulièrement une pensée qui vient de me glacer: si je suis enceinte, je ne garderai pas cet enfant et si mes viscères doivent ne jamais l'oublier, jamais le pardonner, qu'il en soit ainsi. Mon corps ne m'épargnera rien, sale aimant de mains et de gamètes.
Sonne un réveil dont je n'avais pas besoin, je ne dors plus, mime le quotidien apaisé, prépare le petit déjeuner auquel je fais semblant de toucher et, la porte refermée, appelle le méecin, m'habille et traverse une avenue qui me semble un fleuve asséché, la fatigue strie ma vue, les gratte-ciel au loin sont des tesselles de mosaïque mal collées. Au centre de santé, je suis dirigée vers une petite pièce: un bureau, une chaise, une table roulante de métal, du coton, du désinfectant et une fiole à remplir.
"Avez-vous déjà une idée de votre décision si le test est positif?" Je hoche la tête. Ferme les yeux. "Je ne garderai pas l'enfant." Je déglutis.
"Je vais quitter mon compagnon."
Les secondes cognent, le regard par terre: ne pas lever la tête, ne pas voir si la couleur change, la teinte du sol reste, elle au moins, identique. Pas de rouge, surtout, pas de rouge sur la bande de papier. Le sol reste gris. Et le test, blanc. Négatif. Très lisible. "Ce c'est pas toujours le cas", me dit l'infirmière.
Lisible, enfin. Comme ce que j'ai annoncé à cette femme. Dans un étrange alliage de l'esprit, une façon de prendre parfois les inconnus à témoin, nous nous trouvons liés par des mots lancés à un étranger plus encore que par des paroles à des proches car celles-là peuvent être amendées.
Je dois le quitter.
Clémence Boulouque, L'amour et des poussières (Gallimard, 2011)
09:19 Écrit par Claude Amstutz dans Clémence Boulouque, Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
05/01/2012
Pascal Quignard
Bloc-Notes, 5 janvier / Les Saules
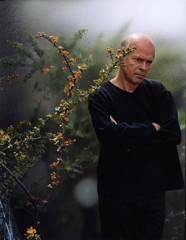
Claire Methuen, la cinquantaine, traductrice à Versailles, rejoint la Bretagne - Dinard, plus précisément - pour assister à un mariage. Elle y retrouve le pays de son enfance et tout ce monde intérieur, secret, vivace qui a fait d'elle ce qu'elle est: Madame Ladon sa professeur de piano, Fabienne sa meilleure amie et surtout Simon, son seul véritable amour, aujourd'hui marié à Gwenaëlle et père d'un petit garçon.
Mais qui donc est Claire, cette amie des Houles qui ressemble à un chemin perdu au-dessus de la mer - nous suggère Pascal Quignard - et pourquoi va-t-elle tout laisser derrière elle et s'installer à la ferme de la Tremblaie? Une autre fuite ou, au contraire, un aboutissement? Au fil de la mémoire de Paul son frère bien-aimé, de Simon bien sûr, de sa fille Juliette abandonnée vingt ans plus tôt, de Madame Ladon qui la considère comme sa propre enfant, de Jean le prêtre ami et amant de Paul, ce roman polyphonique explore et révèle peu à peu la personnalité fascinante, solitaire et craintive de cette femme sans laquelle ces solidarités mystérieuses seraient dépourvues de sens, réduites au seul pouvoir visible des choses qui ne suffit à personne.
On pourrait parler d'osmose dans ce magnifique roman dont les paysages, la nature même, de Saint-Enogat au village de La Clarté, de Saint-Lunaire aux Pierres couchées et la Ville-Géhan semblent absorber dans les tourments, mais aussi dans une infinie douceur, ces destins croisés qui dans l'air parfois aussi rare que les mots, s'ouvrent à une réalité silencieuse qu'eux-mêmes, peut-être, n'auraient envisagée. Un jour, nous dit son frère, elle m'expliqua que le paysage, au bout d'un certain temps, soudain s'ouvrait, venait vers elle et c'est le lieu lui-même qui l'insérait en lui, la contenait d'un coup, venait la protéger, faisait tomber la solitude, venait la soigner.
Tout, avec elle, était adressé à la silhouette lointaine de Simon... C'était un mouvement très sourd mais très intense autour de son corps, qui affleurait sans cesse, frémissait sans cesse autour d'elle, comme une vague circulaire, comme une oppression. Je ressentais ce cercle magique, raconte encore Paul, quand je marchais auprès d'elle des heures durant, je la sentais mais je n'y accédais pas. Et Simon, qui semble n'avoir pas mieux compris le film où il avait obtenu pourtant le premier rôle, par sa mort lève un coin du voile - sans éclaircir pour autant le mystère - qui recouvre le visage de cette femme encore jeune et belle: Elle ne se protégeait plus de rien. Elle descendait vers la mer, qu'on peut presque dire éternelle quand on la contemple beaucoup et pour peu qu'on compare son origine à l'âge des hommes ou à l'invention des cités ou des maisons. Claire était devenue Simon, et était devenue le lieu. Tout était désormais dépourvu de toute crainte. Tout était sublime. Elle était partout chez elle; elle était comme le commencement dans l'origine.
Il règne, dans Les solidarités mystérieuses, une atmosphère ou un climat qui n'est pas sans rappeler Le monde désert d'un Pierre-Jean Jouve, où la vie réelle, attendrissante et forte à ses heures, se mêle à l'absence, à l'indéchiffrable, à l'infini. C'est son corps qui manque à nos heures. Son corps manque déjà au lieu, aux roches. Elle manque à l'escalier de La Clarté qu'elle était bien la seule à emprunter et qu'elle a gravi jusqu'à la fin sans effort. Elle manque aux recoins et aux petites caches d'où elle surveillait les nids, les terriers, les canots, les chaloupes sur la mer. Mon dernier souvenir d'elle? dit encore le Père Calève, un autre personnage du roman: Un troupeau de goélands s'amassent sur la digue pour crier de plus en plus fort autour d'une écharpe, abandonnée, un peu souillée, qui traîne, sur le sol, près du buisson...
Dans un mouvement répétitif et pourtant jamais tout à fait le même, ressemblant aux vocalises des oiseaux sur la lande, se tissent des liens invisibles entre la mort, l'amour et la vie que nourrissent les souvenirs de chacun, exposant sa part de lumière ou d'ombre, mais qui ne se matérialise et ne revêt ses couleurs singulières que confrontée, enrichie, prolongée par la mémoire de tous les autres. Et si c'était cela, la vérité?
La vie est le souvenir le plus touchant du temps qui a produit ce monde.
Avec Pascal Quignard - et je m'en réjouis - l'année nouvelle ne pouvait pas mieux commencer!
Pascal Quignard, Les solidarités mystérieuses (Gallimard, 2011)
Pierre-Jean Jouve, Le monde désert (Mercure de France, 1960)
01:08 Écrit par Claude Amstutz dans Bloc-Notes, Littérature francophone, Pascal Quignard | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
03/01/2012
Morceaux choisis - Pascal Quignard
Pascal Quignard

Il me semble que la mort de Simon ne les a même pas séparés. C'est peut-être même le contraire. Sa mort ne les a pas réunis non plus, mais il est là. Il est constamment là. Il est là avec elle tout le temps. Et réciproquement: elle est avec lui tout le temps. Elle s'occupe de lui. Il est devenu la baie.
Chaque jour elle allait s'asseoir dans son ombre, dans l'ombre de la baie, chaque jour elle allait se caler dans son coin de roche, se dissimuler juste en face du nid du grand goéland de la falaise.
Mon dernier souvenir d'elle? Il y avait un peu d'herbe coupée ras le long du mur de la ferme. Ce mur-là, de l'autre côté des bambous envahissants, était toujours à l'ombre. Ce côté-là de la ferme sentait bon. Il était surmonté d'une grosse glycine plantée par oncle Paul qui amplifiait cette ombre dès la fin du mois de mai. Tout sentait bon. C'était une chaude journée de juin. Nous nous sommes assises toutes les deux sous les grappes de la glycine. Au loin les passereaux secouaient leurs plumes avant de venir boire dans une tasse d'eau qu'oncle Paul avait laissée par terre. Tout était tranquille. Nous étions toutes les deux. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas Paul. Il n'y avait pas Jean. Il n'y avait pas Simon. Maman m'a pris la main et n'a pas dit un mot. Sa respiration était légère. Elle respirait un peu bruyamment. Elle s'était mise à sentir, en vieillissant, une odeur douce de sueur, de foin, de sel, d'iode, de mer, de granit, de lichen.
Pascal Quignard, Les solidarités mystérieuses (Gallimard, 2011)
09:18 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis, Pascal Quignard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
01/01/2012
Morceaux choisis - Philippe Sollers
Philippe Sollers

C'est immédiat: je ne peux pas voir un cèdre, dans un jardin ou débordant d'un mur sur la rue, sans penser qu'une grande bénédiction émane de lui et s'étend sur le monde. La foule est bénie, les autobus, les camions, les voitures, les poubelles, les vélos, les scooters sont bénis. Les plus laids et les plus laides sont bénis, et aussi les vieux, les enfants, les jeunes, les femmes enceintes, les malades, les fatigués, les pressés, les rares heureux, les désespérés. Ils passent tous et toutes sous le cèdre, ils ne le voient pas, sa bénédiction silencieuse, verte et noire, filtre l'espace. On ne sait pas d'où lui vient cette tranquillité, cette ramure de sérénité.
Il vient d'Afrique ou d'Asie, le cèdre, son nom est grec et latin, il souffre au Liban et au Proche-Orient, il s'en fout, il a ses plans superposés, sa longévité, ses légendes. Ses racines pivotent à une grande profondeur, mais sa tige, droite, couverte d'une écorce rugueuse, se termine par une flèche presque toujours inclinée et dirigée vers le nord. Il peut s'élever jusqu'à qurante mètres, et son ombre, produite par de petites feuilles étroites et pointues, est épaisse et large. Il règne, il protège, il paraît méditer, il bénit.
La photo que j'ai sous les yeux a été prise en été par quelqu'un qui s'est assis dans l'herbe pour qu'on voie bien le petit personnage regardant un cèdre. Je dois avoir deux ans, je suis un bébé bouffi qui lève un visage ravi, à moitié mangé de soleil, vers les branches. Anne, ma soeur de huit ans, est à peine visible, devant les vérandas, sur la droite. La photo a dû être prise par mon père, le seul qui, à l'époque, prenait de temps en temps des photos. J'ai l'impression d'être là, maintenant, dans cette image qui n'est pas pour moi une image, mais une clairière toujours vivante, une éclaircie. La petite forme absurde où je suis enfermé a été jetée dans ce coin de jardin, et je suis son gardien. Continue ta marche titubante, bébé. Tu vas tomber bientôt sur le gravier, tu tomberas beaucoup dans ta vie qui commence. Anne va aussitôt crier et se précipiter, te relever, t'essuyer, t'embrasser. Elle t'étouffe un peu, elle te gène. C'est un acte de possession, mais aussi d'amour.
Tu reviendras sans arrêt sous cet arbre. Il a beau y avoir, dans le jardin, des acacias, des noisetiers, un magnolia, un petit bois de bambous, des chênes, c'est ton endroit préféré. Tu vois cet arbre, tu le respires, tu crois l'entendre, tu le rêves. Tu peux te cacher dans les fusains, mais le cèdre, lui, te rend invisible. Tu entres dans son cercle, tu disparais à leurs yeux, pas vu pas pris, caverne à l'air libre. Tu installeras plus tard ta cabane dans le cognassier, lieu d'observation idéal. Ils font semblant de ne pas savoir où tu es, ils t'appellent, tu ne réponds pas, ils jouent le jeu, sauf Anne. Pendant deux ou trois ans, elle vient s'installer à côté de toi, et puis elle renonce. Quand tu as douze ans, elle en a dix-huit, le manège à mariage commence pour elle. Quand tu as vingt ans, elle en a vingt-six, et elle a déjà deux enfants, des garçons, et ensuite une fille d'un second mariage. Il y aura encore quelques fêtes sous le cèdre, mais tu ne seras plus là ...
Philippe Sollers, L'éclaircie (Gallimard, 2012)
07:11 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |
Morceaux choisis - Yves Navarre
Yves Navarre

Oublier ce que j'ai appris, perdre ce que j'ai acquis, voyager, regarder, écouter, engendrer, bâtir, qui sait, je rêve en ne rêvant plus. Cette nuit-là est douce, encore. J'écoute les heures et les demi-heures, chaque fois deux fois, jusqu'au matin pour me lever alerte, décidée, nulle rancoeur pour qui que ce soit, sourire, servir, être là, présente, nulle importance portée à ce qui leur paraît important, toute prête à écouter s'ils désirent partager. Je me lève idéale et fière. La maison n'est plus une prison, j'en ai fait l'inventaire. Ma mère peut agiter toutes sortes d'éventails, gifler le vide, se taire et m'ignorer pour me blesser, elle ne peut exprimer sa tendresse que par violences. Jamais elle n'aura été autant aimée, observée, dessinée et désirée, autre qu'elle ne fut, plus que par moi, paradoxe, mon affection. Cette femme de deuil, infirme de la hanche, m'a tout donné en me refusant tout. Ce matin-là, je m'offre toute ma vie pour m'échapper. Toute une vie pour être, exister, m'abandonner à ce petit monde, cachant un plus grand, siècle où l'on ne vénère que ce qui a été. Passé composé à l'extrême. Au petit déjeuner, je souris. La dame en blanc me trouve pâle. "Vous avez des lèvres violentes." Je souris, souris encore. "Je dirai à Madame que vous lisez en cachette. Vous achetez des bougies, n'est-ce pas? Je sais que vous avez la clé de la bibliothèque de votre père." Je hausse les épaules. Elle me gifle. Je la regarde, imperturbable, un regard droit, un regard de petit nègre et je murmure: "Merci."
Yves Navarre, Je vis où je m'attache (Robert Laffont, 1978)
06:42 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis, Yves Navarre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |
|  Imprimer |
Imprimer | ![]() Facebook |
Facebook |












